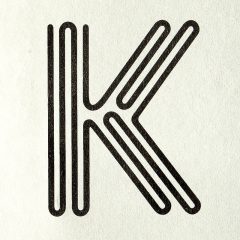Nous sommes partis très tôt ce matin-là de l’île de Gorée ; c’était la fin de nos vacances, un dimanche ensoleillé et veille de L’Aïd el-Kébir. On a pris un bateau pour Dakar, puis un bus local pour nous rendre à l’aéroport, traversant la ville et ses faubourgs en laissant nos yeux glisser une dernière fois sur les gens, les façades, l’agitation des rues et des marchés. Au terminus, il ne restait plus que nous et notre barda.
Nous étions arrivés avec trois heures d’avance sur l’horaire prévu et avions l’intention de petit-déjeuner. En nous dirigeant vers le hall des départs à la recherche d’une cafétéria, sur le parking quasi désert, un inconnu nous a abordés :
— Vous prenez l’avion pour Paris ? Vous avez du temps alors ! Si ça vous dit, je connais un petit restaurant près d’ici, il est très bien.
L’homme avait une quarantaine d’années, grand, habillé d’un polo à manches courtes et d’un pantalon de toile. Il avait parlé tranquillement, une simple proposition qui survenait de manière opportune, mais on se méfiait des rabatteurs. Il poursuivit :
— C’est tout près d’ici, les gens du coin y vont. Il y a tout ce qu’il faut : du pain, du beurre, du café… C’est bon et c’est pas cher, bien moins cher qu’ici.
On hésitait. Après trois semaines à bourlinguer dans le pays, les enfants étaient fatigués et ne voulaient plus bouger, mais avec Oli, on préférait les ambiances pittoresques au décor lisse et ennuyeux des aéroports. Manger ailleurs nous permettait de continuer notre voyage, encore un peu.
— Il est où ce restaurant ?
— Là-bas, a dit l’homme en pointant son doigt vers un point indistinct.
— Je vois rien, il faut marcher combien de temps ?
— C’est pas loin madame, dix minutes, pas plus. Avant, il y avait un gros chantier, ils ont construit une cantine pour les ouvriers. Les travaux sont terminés maintenant mais la cantine, ils l’ont laissée.
Il faisait beau, j’imaginais une petite gargote sympathique avec une terrasse, un lieu ouvert sur l’extérieur. On a dit : « D’accord ! », les enfants ont râlé.
On a repris nos sacs et peu après, on marchait sur une large route bitumée qui s’enfonçait en ligne droite dans un paysage désertique, de la terre ocre à perte de vue. Le soleil cognait dur. On suivait l’homme sans comprendre où on allait, personne à l’horizon ni maison. Aux enfants qui me demandaient : « On arrive bientôt ? », j’étais bien en peine de leur répondre. L’aéroport semblait loin désormais, ça sentait le plan foireux. On s’apprêtait à faire demi-tour, quand deux taxis nous ont doublés lentement et se sont arrêtés devant nous. L’instant d’après, on était entassés, les bagages sur les genoux, à rouler encore un ou deux kilomètres jusqu’à un bâtiment en béton délabré qui éveilla aussitôt mon inquiétude. On a tourné juste avant pour s’arrêter enfin sur un terrain en terre battue où se trouvait une dizaine d’algécos en tôle ondulée. Étaient garés de nombreux taxis dont les couleurs jaune et noir égayaient un peu l’austérité du lieu. Des hommes, des chauffeurs sans doute, semblaient attendre, seuls ou en petits groupes, collés à l’ombre des parois métalliques.
Notre guide s’est dirigé vers un passage étroit entre deux baraquements, suivi par Oli et les enfants, moi fermant la marche à quelques pas derrière. Je les vis bifurquer sur la droite, quand en débouchant à mon tour, je me suis retrouvée face à une décharge d’ordures située juste devant une porte ouverte. Celle du restaurant.
— Je rêve ! C’est dégueulasse ici ! Un vrai dépotoir !
C’est sorti de ma bouche, la patronne est apparue dans l’encadrement. Nos regards se sont croisés. Elle avait déjà disparu quand je suis entrée, effarée. C’était une petite pièce sombre, sale, sinistre, avec deux tables, des bancs et des mouches. Mes enfants s’installaient déjà, pressés de s’asseoir. La femme s’affairait devant son réchaud à gaz. Je lui ai dit « Bonjour ! », elle n’a pas réagi. Oli était debout et me regardait. D’un mouvement du menton, il me demandait de choisir : « On reste ou on se barre ? »
Je n’ai pas pu lui répondre. Il y avait un vieil homme assis, maigre, en chemise, qui mangeait tranquillement son petit déjeuner. Partir aussitôt aurait signifié : « C’est la misère ici, c’est pas pour nous. » Je n’ai pas eu le courage de lui manquer de respect. J’ai mis nos sacs dans un coin et je me suis attablée. La nappe en plastique était tapissée de mouches qui sursautaient à chaque vibration de l’air. Il y en avait sur le sol aussi, où trainaient de-ci de-là des papiers gras, qui en s’agglutinant en corolle autour des salissures formaient de grosses fleurs répugnantes. La nourriture et les baguettes de pain étaient posées sur une desserte ouverte à tout vent, comme l’était l’eau stockée dans un gros bidon dont la partie supérieure avait été coupée.
Le guide a appelé la femme, elle s’est retournée vers nous, le visage fermé. On a commandé des cafés et des chocolats. Il n’y avait pas de chocolat alors on a sorti notre pot de Nesquik que l’on a délayé dans de l’eau chaude avec du lait en poudre. Ensuite, les enfants ont demandé de l’omelette servie quelques minutes plus tard gorgée d’huile entre deux morceaux de pain sec. Dès la première bouchée, ils n’avaient plus faim. De temps en temps, une mouche se collait à leur joue qu’ils chassaient d’un mouvement lent de la main. Oli discutait avec notre guide qui mangeait son sandwich avec appétit. J’avais hâte de partir, de retrouver l’air et la lumière, triste de voir ces hommes et ces femmes côtoyer l’immonde avec indifférence.
Une fois dehors, le guide nous a demandé de l’argent, il disait que grâce à lui, on avait fait des économies. Le lendemain, c’était l’Aïd el-Kebir, il devait acheter un mouton. Je lui en voulais de nous avoir emmenés ici et je m’en voulais d’y être restés.
On quitta le Sénégal sur cette image de désolation.