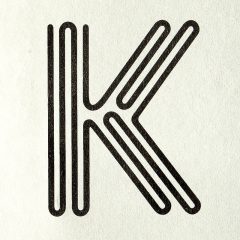Une fanfare m’a cueillie ce matin sans crier gare, dès l’entame des instruments à vent, mon cœur vibrant au rythme du trombone, enflant si fort au son des trompettes que me vinrent des larmes aux yeux. C’était un hymne populaire, aussi entraînant qu’un sirtaki, à la joyeuse mélancolie d’un chant russe. Emportée par l’émotion, je vis le regard humide de ma mère, elle qui avait tant aimé écouter des chansons tristes, tant aimé chanter en chœur, puis j’eus la sensation étrange qu’elle prenait possession de mon corps, qu’elle vivait cet instant à travers moi, jusqu’à ce que le silence revienne. Encore chamboulée, je m’apprêtai à envoyer un message à mes enfants, leur faire entendre la « Peña Baiona », leur dire que je voulais cette musique pour ma cérémonie funéraire. Je me retins à temps. J’ai cinquante-cinq ans, rien ne presse. A quoi bon leur jeter l’ombre de ma mort un jour clair d’hiver.
La fanfare