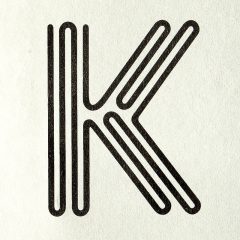J’avais sept ans quand Anne-Marie entra dans la vie de mon père. Elle était suédoise avec un visage de madone aux pommettes saillantes, de longs cheveux clairs et épais qui tombaient droit jusqu’au bas du dos. Elle était réceptionniste dans un hôtel rue Pierre Sémard, tout près de leur domicile, et elle m’y gardait parfois lorsque tous deux travaillaient le week-end. Derrière son comptoir d’accueil, elle était la maîtresse du lieu et je restais fièrement à ses côtés, manipulant les feuilles de son bloc-note et les stylos du pot comme autant d’objets divins pour dessiner. À d’autres moments, je m’installais dans sa petite loge, là où elle laissait son manteau et son sac à main, et je la regardais discrètement accueillir les clients.
L’été, je leur écrivais de ma colonie de vacances. C’est Anne-Marie qui me répondait. Elle me donnait des nouvelles de mon père et de Malissa, un chartreux qui s’enfuyait dès qu’on avançait la main pour le caresser. Pour notre correspondance, elle choisissait un papier fin de couleur rose qu’elle brodait de mots bleus, d’une belle écriture cursive et régulière, tout en boucles penchées.
Elle portait des jupes et des chaussures à talon qu’elle me prêtait le temps de jouer ainsi vêtue au mannequin de mode. Je marchais dans leur salon, la main posée sur la hanche, avec l’impression de défiler devant un large public tant son regard et son sourire emplissaient l’espace.
Un hiver, elle m’emmena en Suède dans sa famille pour y passer les fêtes de fin d’année. Je revins à Paris, la valise alourdie de cadeaux dont le fameux disque d’Abba avec l’hélicoptère sur la pochette et un bol énorme en faïence que mon frère s’appropria d’office pour ses petits déjeuners en proclamant : « Je suis en pleine croissance ! » Je râlais, mais quand mon frère quitta définitivement la maison, le bol ne bougea plus de l’étagère.
Un samedi, quand j’arrivai chez eux, ses affaires avaient disparu. Elle venait de quitter mon père, qui se retrouva seul avec le chat. Elle était partie sans me dire au revoir.
J’habite à présent non loin de la rue de Bellefond, une rue atypique qui s’élève en enjambant la rue Pierre Sémard et chaque fois que je l’emprunte, mes pas ralentissent à l’approche du pont d’où je regarde en contrebas la devanture rouge du petit hôtel, comme on se recueille devant une tombe.
Extrait du roman « Embrasse tes petits pour moi »