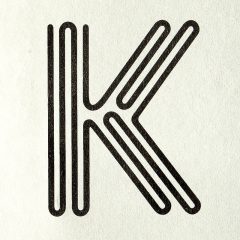Caroline s’occupait de l’entretien de notre immeuble et je la croisais tous les jours ou presque depuis treize ans. Elle arrivait en fin d’après-midi et commençait par ouvrir le local à vélos par lequel elle accédait à une petite pièce pour y déposer ses affaires, puis elle se mettait à la tâche. Elle passait l’aspirateur dans l’escalier, nettoyait à la serpillière le sol du rez-de-chaussée et celui de l’ascenseur, lavait à grande eau la cour intérieure et les pavés du hall, faisait briller les carreaux ainsi que les poignées en laiton du portail et sortait les poubelles à couvercle vert, jaune ou blanc selon le jour de la semaine. On se disait bonjour, on partageait quelques mots ou davantage quand l’occasion se présentait.
Certains soirs, en passant devant le local, j’apercevais sa silhouette et lui faisais un signe de la main sans m’arrêter.
De ma cuisine, je pouvais deviner sa présence à certains bruits familiers qui s’élevaient du dehors ; une porte qui claque, de l’eau tambourinant dans un seau ou tout simplement sa voix lorsqu’elle discutait avec un voisin. Elle restait tard à attendre le passage des éboueurs pour remettre ensuite à leur place les containers, repartant chez elle à la nuit.
Quand j’allais faire mes courses au magasin d’à côté, je l’y trouvais de temps en temps. Le personnel l’appelait « Tati » et lui donnait des invendus qu’elle distribuait à d’autres. Une petite dame venait souvent la rejoindre dans le hall avec son caddie.
Caroline était ivoirienne et n’avait pas revu son pays ni sa famille depuis vingt ans quand sa mère est morte l’an passé. Ses frères et sœurs comptaient sur elle pour s’occuper des obsèques ; c’était la seule de sa fratrie à vivre en Europe. Quand elle me l’a dit, elle était en plein désarroi, peinant à payer ses propres factures.
Elle travaillait aussi dans un autre immeuble du quartier, bien plus grand que le nôtre où elle y passait une bonne partie de sa journée. J’y fis une quête, trois soirs de suite, toquant à toutes les portes jusqu’à rencontrer tous les locataires. Au bout du compte, j’avais récolté de quoi lui offrir un billet d’avion et plus encore. Je souriais en lui remettant l’enveloppe. Elle resta silencieuse, comme sidérée.
Le lendemain, elle revint chez moi, elle était encore toute chamboulée. Elle me confia alors :
— J’ai pas dormi de la nuit. Vous savez, quand je travaille, j’en vois du monde. Je pensais que les gens, ils n’en avaient rien à faire de moi, mais grâce à vous, à ce que vous avez fait, je sais maintenant que je suis aimée.
Elle prit une longue inspiration, puis dit encore :
— Ça fait du bien de se sentir aimé.
A cause du covid, son départ fut repoussé de mois en mois, alors que le corps de sa mère l’attendait en chambre froide. Elle dut se résoudre à la faire inhumer. Loin d’elle.
C’était un jeudi matin. Deux jeunes gens attendaient près du local à vélos. C’était les enfants de Caroline, une fille et un garçon. Ils voulaient récupérer les affaires de leur mère, décédée dans la nuit d’une rupture de l’aorte. Elle était tombée dans la rue, tout près d’ici.
La veille, je l’avais vue Caroline et je la vois encore sortir de l’immeuble au moment où j’y entre. Elle portait comme toujours en hiver un manteau épais, un bonnet de laine et des bottes fourrées. Elle était grande. Elle avait la peau très noire, le visage rond, des pommettes saillantes et quand elle souriait, sa bouche s’illuminait de dents blanches légèrement écartées sur le devant.
J’appris qu’elle avait une autre fille laissée au pays quand elle vint en France. Une enfant qu’elle n’avait pas vue grandir.
Depuis, tous les jours, quand je passe devant le local à vélos figé désormais dans l’obscurité, je pense à elle et je ne peux m’empêcher de regarder au travers de la porte vitrée.